Maurice Perron, Françoise Sullivan et la lumière du nord
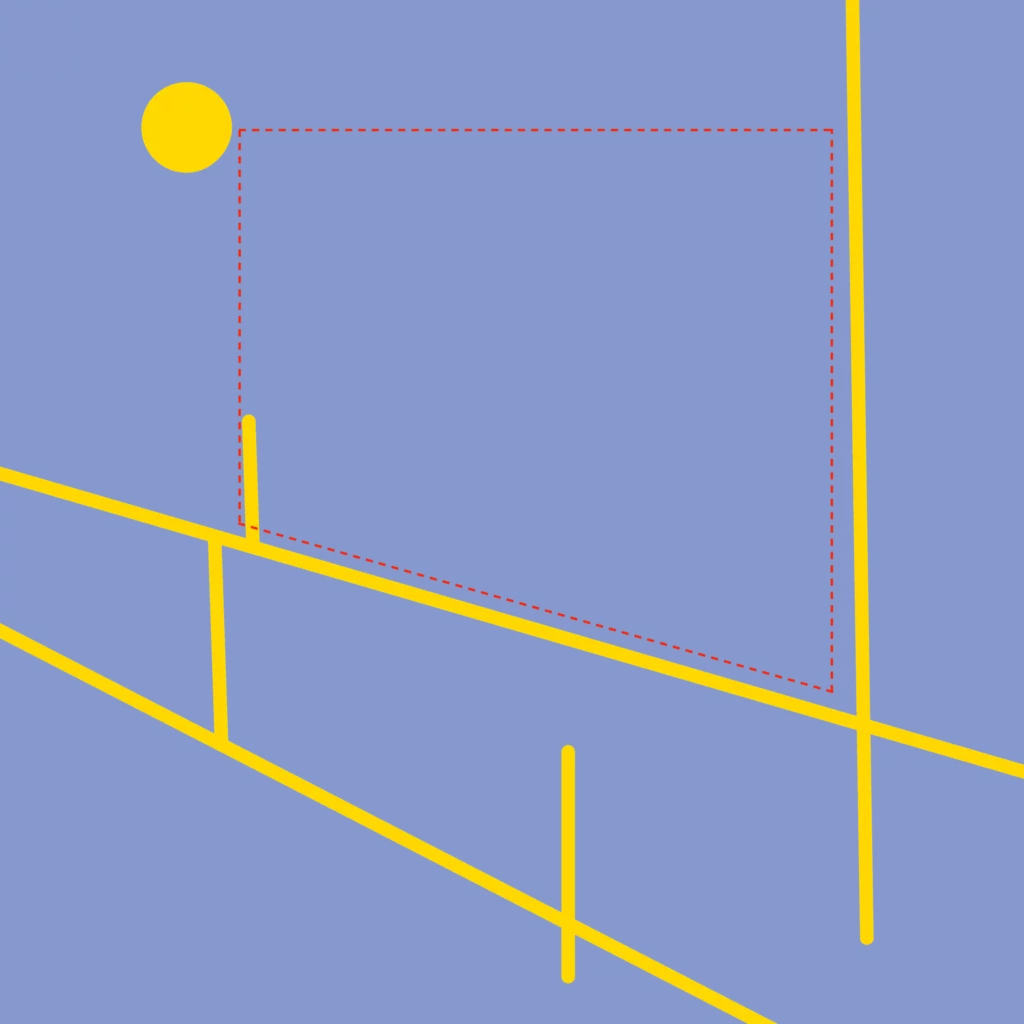
Analyse de la composition de la photo Danse dans la neige, 1948 (MNBAQ 1999.159) de Maurice Perron (1924-1999), montrant la performance de Françoise Sullivan.
(N.B. La photo Danse dans la neige ne peut être consultée que sur le site du Musée national des beaux-arts du Québec.)
L’année 1948 aura marqué un jalon important dans l’histoire de l’art et des médias au Québec. Cette année-là, la parution consécutive de deux manifestes, Prisme d’yeux (4 février) et Refus global (9 août) allait opposer deux visions de l’art. Si on considère aujourd’hui le premier comme inclusif de la diversité des points de vue esthétiques et des sujets en art (figuratifs ou non); le second, plus radical, allait miser sur une vision cohérente d’un groupe profondément lié par des valeurs et affinités idéologiques marqués plus spécialement par l’abstraction.
Par son programme, aligné librement aux idées politiques liées à l’anarchisme d’une part et aux courants artistiques d’avant-gardes européens (aux racines du mouvement dada et du surréalisme) de l’autre, Refus global a pour mot d’ordre une esthétique expressive et lyrique, qui fait foi de son authenticité. Cette tendance en quête d’abstraction tranche avec l’art académique encore enseigné dans les écoles d’art ou techniques québécoises. Elle a été qualifiée, à l’époque, d’automatisme, en référence à l’écriture « automatique » et au « cadavre exquis » qui ont la particularité de faire émerger des images poétiques inédites. De même, qualifiera-t-on les artistes parmi ses seize signataires (7 femmes et 9 hommes) d’« Automatistes[01] ».
Si cet « égrégore[02] » est composé de multiples personnalités qui œuvrent dans des domaines variés, on remarquera que le manifeste du Refus global reflète bien cette réalité, contenant des contributions sur des sujets variés (danse, peinture, sculpture, théâtre, etc.). Le fascicule lui-même, dans sa forme matérielle, a été édité artisanalement par le photographe Maurice Perron. Ce dernier, bien connu pour avoir documenté assidûment les activités du groupe, fonde la maison d’édition Mithra-Mythe afin de pouvoir publier les textes aux accents révolutionnaires de ses comparses. Ce faisant, même s’il ne signe pas de textes de son cru, il truffe l’ouvrage ronéotypé[03] de plusieurs planches de reproductions qui illustrent les essais, des photographies dont il est l’auteur. Certains voient sa contribution comme une prise de position en faveur du média.
Quelques-unes de ces images maintenant célèbres représentent la danseuse contemporaine Françoise Sullivan, signataire de l’un des textes présents dans le manifeste et intitulé La danse et l’espoir. Issu d’une conférence prononcée en février 1948, ce texte est accompagné d’images phares des séries Danse dans la neige et Black and Tan. Captées par Perron lors de performances réalisées dans les jours qui ont précédé ou suivi l’allocution, leur valeur symbolique est tout aussi importante que leur valeur plastique : il s’agit d’un rare témoignage du moment clé de l’incarnation des idées de Sullivan dans une forme dansée. Celle-ci avait préparé un cycle de quatre performances solos improvisées en extérieur, une pour chaque saison, destinées à être filmées et montées ensemble sous la forme d’une œuvre cinématographique[04]. Jean-Paul Riopelle tourna la performance de Sullivan dans la neige, mais les bobines furent perdues alors qu’elles se trouvaient chez Guy Borremans[05].
L’image tirée de Danse dans la neige que nous analysons ici n’est cependant pas celle retenue pour le manifeste. Bien qu’elle fasse partie du corpus original capté la même journée, elle s’en distingue du fait d’avoir été choisie par Perron et tirée en grand format sur un papier aux riches tonalités. De toute évidence, ce tirage était destiné à être exposé : il est même signé par son auteur, ce qui est plutôt rare comme geste d’affirmation, tant pour le photographe lui-même que pour l’époque. Quant à la série complète d’une quinzaine d’images, elle fait l’objet d’un livre d’art en 1977. Il existe sur cet ensemble de photographies une riche littérature qui nous permet de mieux nous en saisir. La performance de danse contemporaine exécutée ce jour-là de février 1948 est au cœur d’un vaste réseau d’interprétations.
Concentrons-nous plutôt sur l’image, dans laquelle on observe une construction astucieuse et bien équilibrée. Dans ce tirage respectant le format carré du négatif original (2 ¼ po x 2 ¼ po), une diagonale structure la représentation de manière dynamique, tout comme elle donne l’impression de scinder en deux le corps de la danseuse. On y retrouve l’horizon oblique de la dune neigeuse en bas, et dans la zone supérieure, le ciel glacial et sans nuages de février alors que descend le soleil. Les deux trapèzes résultants en font apparaître un troisième. En haut à gauche, le soleil qui décline est aligné avec le corps de Sullivan; ses pieds forment avec les racines de l’arbre une deuxième diagonale, dont le tronc complète la forme géométrique.
Ces lignes de force unissent les éléments de l’image dans un équilibre esthétique délicat entre les tonalités, chères aux pictorialistes, et la géométrie rigoureuse des modernistes. La danseuse peut se déplacer librement, mais elle est instable sur sa pente, alors que l’arbre mature, enraciné et immobile dans sa dormance, est patient et stable comme le soleil lointain suivant sa course dans l’infini. Un effet de contre-jour qui entoure son buste et sa tête d’un subtil halo lumineux fait aussi apparaitre le visage de la jeune Françoise. Elle rapproche les bras de son corps pour se réchauffer ou étreindre délicatement une émotion précieuse. Alors que tout semble statique dans cette image, tout est en mouvement : l’instant d’après, l’arrangement se défait et la scène n’existe plus. Cette rencontre entre la danse et la photographie dans un moment d’intensité a donné naissance à une icône de la modernité boréale.
Principales collections
- Musée national des beaux-arts du Québec
- Art Gallery of Ontario
- Musée d’art contemporain de Montréal
- Musée des beaux-arts de Montréal
01 Bruno Cormier était un psychiatre. La peintre Suzanne Meloche (alors la conjointe de Marcel Barbeau) aurait initialement signé le manifeste, mais retirera son nom juste avant la publication, comme il est suggéré dans Barbeau-Lavalette, A. (2015). La femme qui fuit. Éditions Marchand de feuilles.
02 Esprit de groupe, agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini.
03 Système peu coûteux de reproduction à l’encre des documents utilisant une machine compacte à tambour, qui sera éventuellement supplanté par la photocopie.
04 Le projet initial de 1947 n’ayant pas été mené à terme, elle reprit le concept avec une équipe de danseuses et de vidéastes dans Les saisons Sullivan (2007).
05 Hardy-Vallée, M. et Hudon, S. (2024). Reprendre contact avec « La femme image ». Panorama-cinéma.
Bibliographie
Allaire, S. (1998). Un photographe chez les automatistes. Entretien avec Maurice Perron. Études françaises, 34(2-3), 141-155.
Barbeau-Lavalette, A. (2015). La femme qui fuit. Éditions Marchand de feuilles.
Côté, M. (2010). Recréer Danse dans la neige. Ciel Variable, 86, 32-39.
De Blois, N., Porter, J. R. et Perron, M. (1998). Maurice Perron, photographies. Musée du Québec.
Hardy-Vallée, M. et Hudon, S. (2024). Reprendre contact avec « La femme image ». Panorama-cinéma.
Lapointe, G. et Montpetit, R. (1998). Paul-Émile Borduas photographe : un regard sur Percé, été 1938. Fides.
Allaire, S. (1998). Un photographe chez les automatistes. Entretien avec Maurice Perron. Études françaises, 34(2-3), 141-155.
Barbeau-Lavalette, A. (2015). La femme qui fuit. Éditions Marchand de feuilles.
Côté, M. (2010). Recréer Danse dans la neige. Ciel Variable, 86, 32-39.
De Blois, N., Porter, J. R. et Perron, M. (1998). Maurice Perron, photographies. Musée du Québec.
Hardy-Vallée, M. et Hudon, S. (2024). Reprendre contact avec « La femme image ». Panorama-cinéma.
Lapointe, G. et Montpetit, R. (1998). Paul-Émile Borduas photographe : un regard sur Percé, été 1938. Fides.